Habitat inclusif : une alternative solidaire à l’entrée en EHPAD ?

Et s’il existait une autre manière de vieillir chez soi, sans être isolé, tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé et convivial ? L’habitat inclusif séduit de plus en plus de personnes âgées et de familles en quête d’un équilibre entre autonomie, vie sociale partagée et services adaptés. Ce mode de logement innovant, soutenu par l’État et les départements, offre une alternative humaine aux structures traditionnelles comme les EHPAD.
Habitat inclusif : définition et public concerné
L’habitat inclusif désigne une forme de logement partagé, pensé pour des personnes en perte d’autonomie, souvent âgées ou en situation de handicap.
Qu’est-ce que l’habitat inclusif ?
L’habitat inclusif peut prendre différentes formes. Il peut s’agir :
- de petits appartements regroupés dans un même immeuble,
- de pavillons de plain-pied implantés autour d’espaces partagés (grand jardin, salle commune…)
- de chambres individuelles dans une grande maison.
Ces logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et conçus pour favoriser une vie sociale active, sans pour autant être médicalisés. Ils accueillent généralement entre 5 et 10 résidents et sont implantés à proximité des commerces et des transports en commun.
Concrètement, les habitants vivent dans leur propre espace privatif, tout en partageant certains espaces communs et activités. Le cœur du dispositif repose sur un projet de vie sociale et partagée, qui favorise les relations et l’entraide entre voisins.
Quelles sont les personnes concernées par ce dispositif ?
L’habitat inclusif est particulièrement adapté aux personnes fragilisées désireuses de vivre dans un logement indépendant tout en profitant de temps partagés avec les autres résidents.
Il s’adresse principalement :
- Aux personnes âgées, quel que soit leur niveau d’autonomie (GIR)
- Aux adultes en situation de handicap, qui cherchent un cadre de vie autonome et sécurisé.
- À des personnes isolées, fragiles, qui souhaitent rompre la solitude.
Ce type d’habitat peut aussi accueillir des profils mixtes, dans une logique intergénérationnelle ou solidaire. Chaque projet est pensé en lien avec les services du département qui accompagnent sa mise en œuvre.
Quels sont les avantages concrets de l’habitat inclusif ?
A mi-chemin entre le maintien à domicile et l’entrée en établissement, l’habitat inclusif offre de nombreux avantages.
Autonomie et liberté de choix préservées
Contrairement à une maison de retraite, l’habitat inclusif permet de :
- Vivre dans son propre logement, meublé et décoré à son goût.
- Choisir ses horaires, ses repas, son rythme de vie.
- Participer (ou non) aux animations proposées.
L’objectif est clair : respecter la liberté de chacun, tout en favorisant la cohabitation harmonieuse entre les habitants.
Lutte contre l’isolement social
L’une des principales problématiques du vieillissement à domicile, c’est la solitude. L’habitat inclusif y répond en organisant :
-
- Des activités collectives, décidées par les résidents eux-mêmes pour favoriser le bien-vieillir : atelier mémoire, gymnastique douce, marche, cinéma…
-
- La présence quotidienne d’un professionnel (appelé "animateur de la vie sociale") qui accompagne les habitants dans leur vie sociale partagée, en organisant animations et sorties collectives.
Des temps conviviaux pour encourager le vivre-ensemble : repas partagés, jardinage, sorties…
Cohabitation intergénérationnelle et solidaire
Certains habitats inclusifs favorisent la mixité des générations : seniors, jeunes adultes, personnes handicapées peuvent y vivre ensemble. Cela crée :
-
- Un climat d’entraide naturelle.
-
- Une transmission de savoirs et d’expériences.
-
- Un fort esprit de solidarité.
Les projets de vie sont souvent construits par affinités, avec un socle de valeurs communes.
Habitat inclusif : combien ça coûte et quelles sont les aides financières disponibles ?
Contrairement aux EHPAD, l’habitat inclusif n’offre pas de prises en charge globale aux habitants. Il n’existe donc pas de “forfait tout compris” : chaque dépense est facturée séparément, en fonction des services choisis et des besoins de chacun.
Quels sont les coûts à prévoir ?
Il n’y a pas de réponse universelle à cette question. En fait, le coût de la vie en habitat inclusif peut être comparable à celui en maintien à domicile. Il comprend :
- Le loyer et les charges locatives (si le logement est loué),
- L’aide à domicile (si nécessaire),
- Les soins médicaux et paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, podologues…),
- L’alimentation
- Les transports.
Il faudra également s’acquitter des frais inhérents à la rémunération de l’animateur ainsi qu’à ceux relatifs aux activités collectives et équipements communs.
Comment financer ce projet ?
Pour faire baisser la facture, différentes aides financières peuvent être sollicitées :
-
- L’APL ou l’ALS : versées par la CAF ou la MSA, ces allocations permettent de réduire le montant du loyer. Elles sont soumises à conditions de ressources.
-
- L’AVP (Aide à la vie Partagée) : cette aide spécifique est destinée à financer l’animation de la vie sociale et partagée. Elle est versée par le département à la structure ou au porteur du projet. Le montant attribué peut atteindre les 10 000 € par an et par habitant, et varie en fonction des objectifs et actions prévues dans le cadre du projet de vie partagée.
S’ils répondent aux conditions d’attribution, les habitants peuvent également percevoir des aides propres à leur situation personnelle :
-
- L’Allocation d’Autonomie Personnalisée (APA) : attribuée par le Conseil départemental, l’APA permet de financer une partie de l’accompagnement nécessaire (toilette, repas, ménage…). Son montant varie en fonction du niveau de dépendance de l’habitant (GIR).
-
- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : destinée aux personnes en situation de handicap, cette prestation permet de financer les dépenses nécessaires à la compensation du handicap.
-
- Les dispositifs fiscaux : les habitants faisant appel à une aide à domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur les frais engagés pour ces services.
Le rôle de la CNSA et des départements
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pilote le financement national de ce dispositif. Elle travaille en étroite collaboration avec les départements, qui :
- Approuvent et accompagnent les projets de vie partagée.
- Apportent un soutien financier adapté
- Coordonnent les acteurs locaux (bailleurs sociaux, associations, collectivités…).
|
À savoir : Loi ELAN et décret PLAI de 2023 L’habitat inclusif est reconnu et soutenu par l’État depuis la loi ELAN de 2018, qui le définit comme un type de logement social innovant. Le décret de 2023 a introduit une avancée clé : il a rendu possible le financement des projets d’habitat inclusif via le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), ce qui a permis de faciliter l’accès aux logements sociaux et très sociaux (à faible loyer) tels que les HLM pour les personnes les plus fragiles. |
Habitat inclusif et autres solutions d’hébergement : que choisir ?
L’habitat inclusif est une solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l’entrée en institution.
Différences avec les EHPAD traditionnels
L’EHPAD est une structure médicalisée. L’habitat inclusif, lui, ne l’est pas.
Il ne propose donc pas de soins médicaux sur place, mais les habitants peuvent si nécessaire faire appel à un SSIAD ou à un SPASAD pour bénéficier de soins et d’accompagnement à domicile. Cette prise en charge peut être insuffisante en cas de pathologie lourde ou de dépendance importante. L’état de santé et le niveau de perte d’autonomie de la personne âgée sont donc des critères majeurs pour savoir lequel de ces deux types d’accueil lui correspond le mieux.
En habitat inclusif, aucun rythme de vie n’est imposé. Les résidents gèrent entièrement leur emploi du temps, sans contrainte. En ce sens, ce type d’hébergement offre plus de souplesse au quotidien que les EHPAD.
Comparaison avec les colocations seniors
La colocation entre seniors et l’habitat inclusif ont un point commun : vivre ensemble pour rompre l’isolement. Mais leur fonctionnement diffère.
L’habitat inclusif propose un hébergement avec un projet de vie en groupe. Il est soutenu par l’État et peut donner droit à une aide financière spécifique : l’Aide à la Vie Partagée.
La colocation senior, elle, repose sur l’idée de vivre à plusieurs, sans cadre officiel ni aide dédiée.
Dans les deux cas, les soins et services à domicile sont réalisés par des intervenants extérieurs, sollicités à la demande et ne sont pas inclus dans le loyer.
Intérêt par rapport au maintien à domicile
Rester seul chez soi peut devenir difficile avec l’âge. L’habitat inclusif permet de :
- Préserver son intimité grâce à un logement individuel, tout en vivant au sein d’un groupe.
- Profiter de services mutualisés : ménage, repas, animations.
- Alléger la charge mentale des proches aidants.
Les limites actuelles du dispositif
Freins institutionnels et disparités territoriales
Le développement de l’habitat inclusif reste inégal. Certaines régions sont très en avance, d’autres manquent encore :
- De porteurs de projets.
- De coordination entre services.
- De soutien actif de leur département.
Financement de l’animation : un défi récurrent
Le rôle de l’animateur est primordial dans la concrétisation du projet de vie sociale. Pourtant, de nombreux habitats inclusifs se heurtent à la problématique du financement de ce service. En effet, bien qu’utile, l’AVP ne couvre pas toujours l’ensemble des besoins. Et il est souvent difficile de financer un poste d’animateur à temps plein, ce qui rend nécessaire l’implication d’associations ou de bénévoles. Cette situation peut parfois fragiliser la cohésion sociale au sein de certains habitats.
Visibilité encore limitée auprès du grand public
Beaucoup de familles ne connaissent pas encore ce modèle, qui reste souvent cantonné aux milieux associatifs ou médico-sociaux et bénéficie d’une moindre médiatisation que les EHPAD ou les résidences seniors. Pourtant, grâce au soutien accru des départements, son développement est aujourd’hui en plein essor.
Sources :
www.monparcourshandicap.gouv.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
Par l'équipe rédactionnelle de Retraite Plus
Mis en ligne le 04/08/25
Partagez cet article :
Note de l'article :
Vous recherchez un établissement pour votre proche ?
Obtenez les disponibilités & tarifs
Remplissez ce formulaire et recevez
toutes les infos indispensables
Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Inscription sur bloctel.gouv.fr
Derniers posts
Vous recherchez un établissement pour votre proche ?
Obtenez les disponibilités & tarifs
Remplissez ce formulaire et recevez
toutes les infos indispensables
Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Inscription sur bloctel.gouv.fr
Vous avez besoin d’une aide de nos équipes ?
Obtenir les tarifs & disponibilitésObtenez les disponibilités & tarifs
Remplissez ce formulaire et recevez
toutes les infos indispensables
Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Inscription sur bloctel.gouv.fr









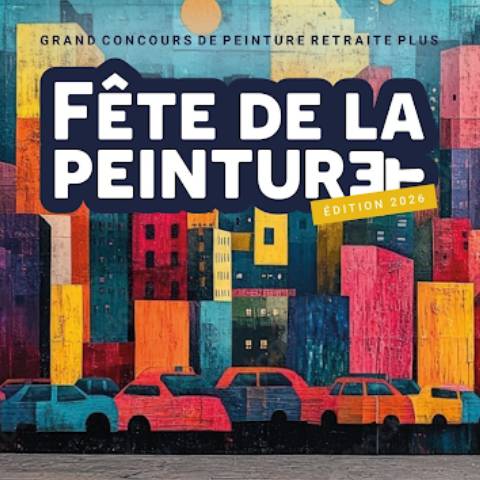



Modération a priori
Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.